Hazrat Inayat Khan: la religion a un sens différent chez les soufis
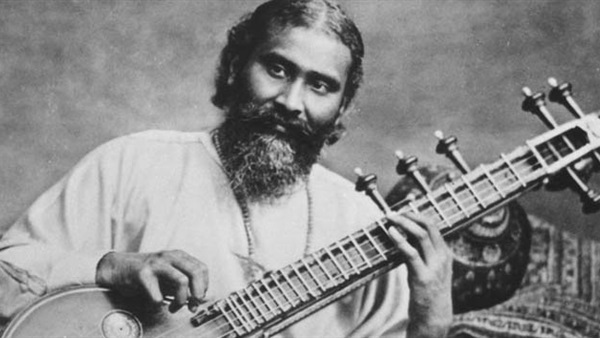
|
Profil Hazrat Inayat Khan: la religion a
un sens différent chez les soufis Nahla ‘Abdel Mun’im C’est loin de tout extrémisme et de tout
attachement excessif à la lettre des textes qu’Inayat Khan a transmis les
enseignements du soufisme en Occident, en fondant le Mouvement du soufisme
universel qui continue de diffuser ses enseignements dans les pays européens. Hazrat Inayat Khan est né le 5 juillet
1882, dans une maison de l’Etat de Baroda en Inde où l’on entendait les sons
des instruments de musique et les chants soufis, dans une famille de
musiciens connue depuis des générations. Son père, Mashaikh Rahmat Khan, né en 1843
dans l’Etat du Pendjab, appartenait à une famille vénérable de propriétaires
terriens féodaux, de saints soufis, de musiciens et de poètes connus sous le
nom de « zamindars ». Sa mère, Bi Khatija, était la fille de
Sholay Khan Maula Bakhsh, qui était un musicien indien, poète, chanteur et
compositeur (1833-1896), et dont la notoriété en tant qu’artiste fut encore
renforcée en tant que grand-père du fondateur du Mouvement du soufisme
universel. Bakhsh a joué un rôle important dans la
formation d’Inayat à la musique et aux chants de paix, et ceci en renforçant
les liens entre son gendre soufi (le père d’Inayat) et la famille de
musiciens, au sein de la maison confortable située sur un côté de la route à
Baroda et qui devint le lieu de rencontre des poètes, des disciples et des
compositeurs, quelles que soient leurs croyances et leurs appartenances
religieuses. Passion artistique et élévation
spirituelle Cette famille a contribué, par ses
penchants pour l’art et la musique soufis, à former la personnalité de Hazrat
Inayat Khan. En effet, ses parents musulmans étaient des adeptes de la
confrérie soufie Chishtiya, qui s’était alors largement répandue, étant donné
que les dirigeants mongols à cette époque l’avaient soutenue pour contrer
l’extrémisme dogmatique et dans l’espoir que le soufisme unisse les
communautés confessionnelles d’alors (musulmans et hindous) contre
l’occupation britannique du sous-continent indien. La famille organisait ainsi des séances
nocturnes d’invocation de Dieu séparées par des prières et des soirées
poétiques et de chants, ce qui emporta Inayat loin de la rigidité textuelle
des livres de religion jusqu’aux vastes espaces de l’unicité de Dieu, l’Un,
le Dominateur, dans laquelle se fondent toutes les religions monothéistes,
selon une explication pratique du terme « gnosticisme » qui fait passer
l’individu de la rigidité livresque à une philosophie religieuse plus
profonde qui insiste sur la relation de Dieu avec Ses serviteurs croyants. Inayat Khan manifesta dès son plus jeune
âge une passion pour la musique, et à neuf ans, il chanta le cantique fameux
« Sanskrit » lors d’un concert officiel à la suite duquel il obtint
un prix décerné par la Maharadjah (dirigeant indien) de l’époque, outre une
bourse d’études. Et à l’âge de 14 ans, il publia son premier livre sur la
musique, sous le titre « Balasan Gitmala », écrit en langue
hindoustani. Et peu avant vingt ans, il se lança dans l’enseignement de la
musique, comme professeur à l’Académie de musique fondée par son grand-père
en 1886, qui s’appelait alors « Gayanshala » - aujourd’hui
« Faculté de musique de Baroda ». La recommandation de
« Mawlana » Etant donné l’influence énorme exercée par
« Maulabakhshi » sur la personnalité de son petit-fils, Inayat Khan
fut choqué par la mort de son grand-père en 1896, et quatre ans seulement
plus tard, son jeune frère Karamat Khan, qui n’avait pas atteint dix ans,
mourut à son tour, ce qui laissa en lui une profonde blessure et le poussa à
composer davantage d’œuvres artistiques et musicales, pour oublier sa
tristesse. Celles-ci se succédèrent et connurent un grand succès à l’époque,
et cette période difficile de sa vie l’amena à voyager à Hyderabad. Ce voyage
représentera un nouveau point de départ dans sa vie, et il composera de
nombreuses œuvres durant ses six premiers mois dans cette ville dont la plus
connue fut son dernier livre sur la musique :
« Minqar-i-musiqar » dans lequel il présente longuement la
philosophie musicale de son grand-père. Le hasard voulut également qu’il rencontre
Mohammad Abou Hachimi Al-Madani (Mawlana Al-Hachimi) auprès duquel il apprit
par la suite les enseignements soufis des confréries Chishtiya, Qadiriya et Naqchbandiya. Car Al-Hachimi était chercheur en
littératures persane et arabe, et en outre, un soufi éminent qui vivait au
milieu des tribus de l’Inde, et était influencé par ses origines musulmanes
et arabes médinoises. C’est ainsi que Khan entendit par hasard
dans la maison d’Al-Hachimi un cours sur la métaphysique et le soufisme, et
il écrivit tout ce que lui dicta Al-Hachimi, avant de s’engager sur sa propre
voie, celle de la recherche de la perfection et de la philosophie de
l’unicité. Et cette relation influa également sur la conception d’Inayat Khan
en matière artistique. Cette influence profonde se manifesta dans
les œuvres d’Inayat Khan sur la relation entre le disciple et son maître, et
ses conséquences sur la vie spirituelle de l’individu, ainsi que sur son
examen des termes soufis relatifs à l’anéantissement de l’égo, et la
découverte de l’essence de l’existence. Et alors que Mawlana Al-Hachimi était
à l’agonie, il conseilla à Inayat Khan de partir en Occident pour y
transmettre le soufisme avec le charme de sa musique. Maturité sensible Deux ans après le décès d’Al-Hachimi, en
1910, Inayat Khan part en compagnie de ses frères pour Calcutta, dans le but
de s’embarquer pour l’Occident, imprégné de connaissances artistiques et armé
d’une maturité spirituelle acquise grâce au soufisme avec toute sa grandeur.
C’est la France qui fut sa première étape européenne. Il y resta de 1912 à
1920, et y étudia la psychologie, tout en donnant des spectacles musicaux
indiens en compagnie de ses frères. En outre, il commença à présenter des
initiatives soufies et à éduquer les disciples sur ces questions. Il voyagea également un certain temps en
Grande-Bretagne, avant de revenir en France pour en faire une base pour la
diffusion du soufisme en Occident, et y créer le Mouvement du soufisme
universel, puis à Londres en 1916, et à Genève en 1922. Le Mouvement est
actuellement dirigé par son petit-fils Pir Zia Inayat Khan. Inayat Khan a publié un grand nombre de
livres dans lesquels il explique sa philosophie religieuse en matière de
soufisme et d’unicité divine, dont les plus connus sont « Le Mysticisme
du son », « Le Message du soufisme », « Le Cœur du
soufisme », « La Voie de l’illumination », « La Vie
intérieure », et « Musique ». Avec l’augmentation de sa notoriété et de
ses obligations scientifiques, Inayat Khan multiplia les voyages en Europe et
aux Etats-Unis, où il diffusa le soufisme par le biais de conférences et de
colloques qu’il organisait régulièrement dans la banlieue de Wissous en
France, où il habitait, outre des conférences en Hollande, et cela de 1921 à
1926. Durant cette époque, Inayat épouse Ora Ray
Baker, puis Amina Begum, dont il aura quatre enfants qui contribuèrent au
bien de l’humanité en poursuivant l’œuvre de leur père en matière de
diffusion des enseignements du soufisme, et certains ont leur statue érigée
sur certaines places. Parmi ses fils les plus éminents ayant
porté le flambeau du soufisme en Occident figure Pir Vilayat Inayat Khan, né
en 1916, et qui a dirigé le Mouvement du soufisme universel de 1956 à sa mort
en 2004, et contribué à la diffusion du soufisme en tant que moyen
d’ascétisme, de méditation, de pratiques spirituelles, et de perfection dans
la recherche de Dieu. Mais sa fille la plus célèbre et celle qui
a été la plus influencée par ses enseignements sur l’acceptation de l’autre
est la princesse soufie Nour Inayat Khan, qui a travaillé comme officier du
renseignement britannique après avoir quitté la France durant la seconde
guerre mondiale. Elle refusait en effet les pratiques nazies et rejoignit les
services de renseignements britanniques qui la formèrent à la télégraphie
sans fil, puis l’envoyèrent en France pour y espionner les forces allemandes.
Mais suite à une dénonciation, elle fut arrêtée et torturée, puis exécutée en
1944. Une statue fut érigée au milieu du jardin
Golden Square Gardens à Londres en souvenir de cette musulmane née en 1914,
et qui s’était sacrifiée pour sauver des juifs de la violence d’Hitler. Et en 1926, après avoir passé des années à
présenter ses enseignements soufis en Europe et aux Etats-Unis, Inayat Khan
décida de retourner en Inde, où il mourut à Delhi le 5 février 1927, après
des années passées, lui et ses fils et petits-fils après lui, à enrichir
grâce à eux le monde. |






