"Abou Zahra", l’icône des réformateurs religieux des années soixante
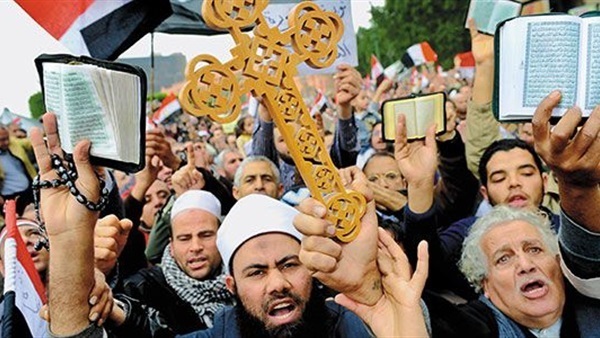
Le cheikh Mohamed Ahmed Moustafa, plus célèbre sous le nom d’«Abou Zahra»
naquit en 1898, dans le Gouvernorat de Gharbiyeh, (en Egypte). Il y mémorise le
Coran, apprit à lire et écrire, puis va poursuivre ses études à la mosquée
Al-Ahmadi à Tanta, l'un des phares de la science à l’époque. Trois ans plus
tard, il déménage à l'École de la magistrature chariatique du Caire, où il
passe huit bonnes années, jusqu'à ce qu'il obtienne la Shahpada al Alamiyya
(Licence) en 1924. Ensuite il va à la faculté de Dar Al Ulûm (Maison des
Sciences) pour obtenir l'équivalence de sa Shahpada al Alamiyya en 1927. Il est
alors sélectionné pour enseigner à la Faculté de Théologie, et participe à la
fondation de l'Institut d'études islamiques.
L'École de la magistrature chariatique fut le premier noyau de la réforme
religieuse, la lutte contre l'idéologie extrémiste et la critique du patrimoine
(islamique). Cette Ecole naquit entre les mains de Mohamed Abdo, décédé bien
avant son achèvement, mais Saad Zaghloul, à l'époque ministre de l'Éducation,
l’adopta et la fit revivre. Elle « produisit » un certain nombre de
chercheurs qui acquièrent des sciences religieuses au même titre que les
sciences contemporaines, bénéficiant d'un certain degré de flexibilité dans les
notions religieuses, parvenant à réviser l’héritage religieux de tout genre
d'extrémisme et d’intolérance, et ayant, bien entendu, un grand rôle dans
l'enrichissement de l'histoire littéraire, scientifique et religieux.
« Abou Zahra, » faisait partie des diplômés de cette école. En effet, l’une
de ses critiques les plus virulentes, contre un certain nombre de cheikhs
d'Al-Azhar, fut son rejet de certains hadiths (traditions prophétiques) authentiques,
étant donné que, selon lui, ils allaient à l’encontre de la raison et de la
logique. Critiques vilipendées par les ulémas contemporains, car ils pensaient
que tout ce qui a été rapporté du Messager d'Allah (paix et salut d’Allah sur
lui) devait être cru.
Par rapport à la question du « Voyage Nocturne et de l'Ascension »
(Al-Isrâ' wal Miʿrâj, ou Isra et Miraj), Abou Zahra dit dans son livre «Le
Sceau des Prophètes» (Khâtam Al Anbyâ’e) ce qui suit :« Suite à nos
recherches nous parvenons à une conclusion selon laquelle si (le prophète, paix
et salut d’Allah soient sur lui) fit l’Isra (le Voyage nocturne) par le corps
et l'âme, l'Ascension (Miraj) quant à elle ne fut que par l'esprit. Ce fut donc
un rêve authentique, non seulement pour l'absence de preuve tangible du Saint
Coran qu'il le fit par le corps et l'âme, mais aussi pour l'existence de
contradiction entre le texte rapporté et la logique (al-ʿaql wa-l-naql)"
Dans le même sens, il attribue également certaines histoires étranges
relatives à la religion au fait que les mosquées accueillaient tant de conteurs
qui racontaient les histoires et les mythes, dont les unes étaient fondées et
les autres non, soulignant que ces histoires étaient la cause pour laquelle de
nombreux contes israélites se sont infiltrés dans les « tafâssir »
(livres d'interprétation du Coran) et de l'histoire islamique. Il pense
également que ces histoires prenaient un angle spécifique et que le fait qu’il
y avait de nombreuses sectes et controverses politiques à l'époque, a rendu ces
histoires biaisées, sans aucune transcription logique.
Par ailleurs, Abou Zahra considère les « Mu’allafat
Qhulûbuhum » (ceux dont les cœurs sont à gagner -à l’Islam-) parmi les
musulmans comme des matérialistes qui ne se souciaient seulement que de
l'argent. "Alors que la part du Mujahid (combattant) du butin qu’il a
arraché par son épée était de quatre chamelles, la part d'Abu Sufyan en était
de cent. Et « ceux dont les cœurs sont à gagner » sont des
matérialistes ; car ils ne sont plus attirés que par le matériel que par
la vérité abstraite.
Simplification des affaires religieuses
Lors de la Conférence sur le droit islamique tenue en 1972, Abou Zahra
déclenche une question à propos de laquelle les conférenciers s’acharnèrent sur
lui à cette époque. En effet, il déclare qu’il était convaincu que « la
lapidation » n'est pas de la religion islamique, et qu’elle était à l’origine
de la législation juive, que le Prophète (Paix et salut d’Allah soient sur lui)
a approuvée, et qui fut par la suite copiée dans la sourate « la Lumière »
(An-Nur).
L’érudit qu’il était, Abu Zahra fut directeur du Département Fatwas dans le
magazine Liwa’ al-islam (L’étendard de l'Islam). A cette époque les fatwas
étaient caractérisées par la simplification des questions religieuses et le
fait d’éviter la complexité et l’extrémisme, étant donné qu’à cette époque
l'idéologie wahhabite était à ses débuts de domination dans le Monde arabe.
Mohamed Abu Zahra est l’un des pionniers et partisans de la réforme
religieuse dans la mesure où cela se manifeste, à cette période, dans ses
fatwas et les questions qu’il souleva et discuta dans un certain nombre de
conférences. Sans oublier ses œuvres qui traitent de la religion avec beaucoup
plus d'objectivité et de simplicité, loin de toute raideur et d'extrémisme.
Abu Zahra écrivit une trentaine de livres, notamment « le Sceau des
Prophètes (trois volumes), « Le grand miracle : le Saint
Coran », « L'histoire des doctrines islamiques » (deux parties
dans un seul volume), « La peine dans la jurisprudence islamique »,
« La criminalité dans la jurisprudence islamique », « Le statut
personnel », entre autres.
Tous les propos ou les écrits d’Abou Zahra sont caractérisés par sa vision
objective de la religion, le fait de se libérer du patrimoine et des avis des
ancêtres et le fait de compter beaucoup plus sur la raison (en ce qui concerne
les questions relatives à la) législation islamique, et de rejeter tout ce qui
ne corrobore pas avec la raison et la logique.






